TEXTES
Le cinéma est pour moi le plus important de tous les arts.
Je lui ai également rendu hommage dans une série d’infographies
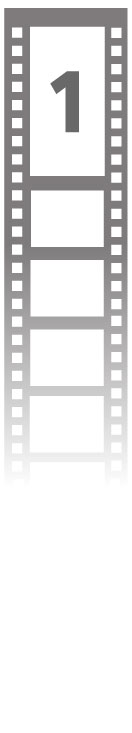
AMORCES
Le mercredi matin, c’était le nouveau monde. Toutes les salles de cinéma changent de programme ce jour-là. La veille, après la dernière séance de la soirée, les projectionnistes ont replacé dans leurs boîtes en fer-blanc les cinq ou six bobines constituant le film, remis ces galettes dans un grand sac de jute, et le ballet, la noria, la navette des fourgonnettes, des cars, des trains et des avions s’est animée dans la France entière, pour amener à Lyon le film qui vient de terminer sa semaine à Marseille, à Nantes celui de Strasbourg, à Paris celui de Digne.
Au début, le seul moyen de connaître les programmes consiste à se rendre devant chaque cinéma pour découvrir l’affiche du nouveau film. Ensuite, dans certaines villes, le système se perfectionne. Les directeurs de toutes les salles se mettent d’accord pour faire imprimer une affiche commune. Ils la font apposer un peu partout en ville et dans les environs.
Dès la semaine précédente, à condition d’avoir assisté à une séance, on a pu avoir une idée du programme suivant: chaque salle a projeté, parmi le fouillis de sa première partie, la bande annonce du film prévu «prochainement dans cette salle». Et puis, un panneau ou un emplacement d’affichage est généralement consacré dans le hall aux affiches des films à venir.
Il n’empêche que le mercredi matin, notre premier souci est de nous rendre devant l’un des emplacements réservés à l’affiche des films de la semaine, en plein centre de la ville, à côté d’un bistrot ou d’une boulangerie, et de laisser la demi-douzaine de films de la semaine nous sauter aux yeux. Bien qu’ils soient présentés dans le plus grand désordre, la rareté à voir absolument si possible avec le divertissement du samedi soir, le film “rose” à côté du western de Ford, la version originale et le navet doublé, on a vite fait de repérer la case de la salle d’art et d’essai.
La béatitude qui se lit parfois sur nos visages, et les cris mal maîtrisés qui nous échappent, feraient prendre, à des passants ignorants, certains d’entre nous pour des simples d’esprit.
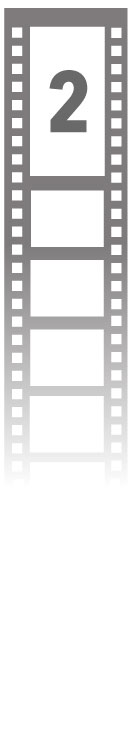
LES TICKETS
Le billet délivré à la caisse doit être conservé durant la projection, en cas de contrôle du CNC. On le glisse dans sa poche ou son sac après que l’ouvreuse en a découpé le talon et restitué l’autre morceau. De retour chez soi, on ne range pas systématiquement ce qu’on a pu accumuler à l’extérieur. C’est ainsi qu’un jour, on se retrouve à la tête d’une quinzaine de tickets de cinéma de couleurs variées. Il n’en faut pas plus pour décider de commencer une collection. On choisit alors une boîte en métal vidée de ses biscuits, une corbeille de vannerie, voire une boîte à chaussures, une grande enveloppe de récupération ou un sac en plastique, qui petit à petit, au fil des séances, au gré des programmations dans les divers lieux pourvus de salles de cinéma, s’emplit de ces petites acquisitions. Le processus d’accumulation est rigoureux sans excès. On n’hésite pas à demander leur ticket aux personnes qui nous accompagnent. En revanche, on ne ramasse pas celui qui vient d’être jeté à terre par l’inconnu sorti devant nous.
Au bout de quelques années, on se retrouve nanti d’une collection considérable. On renverse le contenu de la boîte, du sac, de l’enveloppe sur une grande table, après avoir fait sortir de la pièce tout bébé ou chat qui pourrait s’y trouver, et on passe quelques heures à faire d’utiles et profondes observations sur l’évolution du prix des places, le nom des salles à travers les villes, le logo du CNC toujours identique à lui-même, le format et la taille des tickets immuables à travers les saisons. On décide de faire une mise à plat. On découpe un grand panneau de carton ondulé en bon état, et on colle dessus, une par une, les différentes pièces de sa collection. Ceci fait, on recouvre le tout d’une grande feuille de papier transparent adhésif pour réaliser la plastification qui solidifie l’ensemble, non sans force cris de mauvaise humeur dus à l’incommodité du matériau. Bien entendu, les tickets ne sont pas collés au hasard sur le panneau. On a adopté un principe de base, on dispose par année, par salle, par couleur… On a même pu décider, dans certains cas particulièrement esthétisants, de réaliser une mosaïque, avec comme motif central une caméra, un clap, la tête de Charlot… On a inventé un artisanat original, dont on ne songe pas à tirer profit. De toute façon, une fois terminé et accroché sur un mur, le panneau de cinéma fournit aux soirées mondaines un merveilleux sujet de conversation.
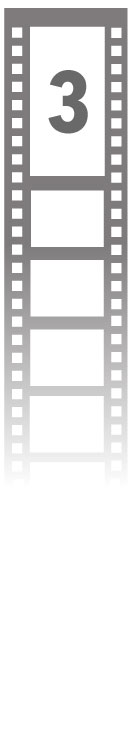
LES OUVREUSES
La plupart des salles, en particulier celles d’art et essai, suppriment peu à peu les emplois d’ouvreuse. Certaines cependant en maintiennent encore. On ne peut pas dire que cela nous fasse plaisir. Notre tempérament pacifique et contemplatif, notre désir de savourer en paix et à notre guise les chefs-d’œuvre, films intéressants et même navets immondes (dont on ne citera pas d’exemple) s’accommodent mal de ces personnes à l’âge et aux formes incertains, dont le seul rôle à notre avis consiste à nous soutirer vingt centimes après avoir sauvagement déchiré en deux morceaux le bout de carton léger que nous souhaitons ajouter à notre collection. Nous n’aimons pas les entendre nous insulter lorsqu’elles comprennent que nous n’avons aucune intention de leur donner de pourboire. Et, bien qu’en général nous soyons conscients de la nécessité de soutenir les justes luttes des travailleurs, bien que nous sachions, pour nous l’être fait répéter maintes fois, que leur seul revenu est constitué des pourboires des spectateurs, nous les trouvons totalement inutiles, et parfois même nous le disons aux plus agressives.
Nous trouvons certaines d’entre elles carrément nuisibles, lorsque prenant à cœur leur rôle de conseil en choix d’une place, elles veulent nous introduire de force dans le huitième siège de la douzième rangée, où nous remplirons une case de leur jeu électronique avant la lettre. Elles mettent en effet un point d’honneur à ne pas commencer une nouvelle rangée avant d’avoir entièrement comblé la précédente. Nous voir les dépasser après avoir laissé déchirer notre ticket, et aller occuper le siège médian de la deuxième rangée les plonge dans la fureur la plus noire.
Pour peu que la projection enfin commencée, nous posions précautionneusement nos chevilles sur le dossier du fauteuil de devant, la salle entière a alors le privilège d’assister à leur vengeance, voyant éclairer nos jambes par le puissant faisceau de leur lampe de poche, et entendant une voix, assez peu distinguée mais ferme et sonore, nous intimer l’ordre de nous asseoir «comme il faut». Ces ouvreuses-là, on les connaît. On évite de les provoquer, et on attend, dans les salles où elles sévissent, un laps de temps suffisant avant de s’installer, pour qu’elles aient le temps de retourner dans le hall, dans une loge, ou dans le quelconque endroit mystérieux où elles se tiennent en dehors des entractes.
Il existe aussi la race des approximatives, qui ne savent jamais où elles en sont de leur remplissage, et à qui l’arrivée d’un retardataire dans la salle éclairée seulement par les lueurs provenant de l’écran occasionne des maux de tête violents. Elles essaient de lui trouver une case vide en braquant leur lampe de poche dans les yeux des spectateurs déjà installés, et guident à grand renfort d’exclamations le malheureux retardataire qui se fait tout petit pour essayer de faire oublier le désagrément dont il est cause.
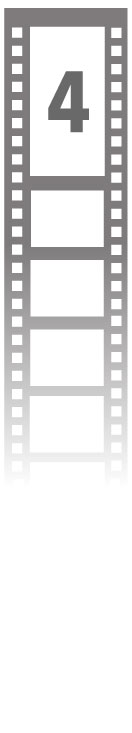
LES PLACES
L’entrée de la salle peut se situer au fond de celle-ci, derrière le dernier rang de fauteuils, ou devant, sous l’écran. Les occasionnels, ceux qui mettent les pieds dans le cinéma pour la première fois depuis un an, ainsi que beaucoup d’autres qui viennent plus souvent, s’installent tout au fond. Y a-t-il chez eux l’arrière-pensée de surveiller l’ensemble de la salle, celle de ne pas être observé à son insu, celle de protéger ses arrières ?… La plupart s’installent au milieu, ni trop près ni trop loin de l’écran, qui est la seule raison d’une visite en ces lieux. Pour nous, autochtones, habitants naturels des salles de cinéma, les seules vraies places se trouvent près de l’écran, dans les quatre ou cinq premiers rangs de fauteuils.
Contrairement à ce qu’affirment les brocards et pointes diverses régulièrement lancés, ce n’est pas parce que notre vue est basse — il n’y a parmi nous pas plus de porteurs de lunettes que la moyenne, et de toute façon celles-ci corrigent parfaitement tout défaut éventuel. C’est que nous n’aimons voir personne entre le film et nous, et surtout pas les gesticulations et inclinaisons brusques alternativement vers le voisin de droite ou de gauche, les statures dépassant les prévisions de l’installateur des fauteuils, les chapeaux, les choucroutes, tout obstacle enfin qui s’interposerait entre notre regard avide et la surface totale de l’écran.
En se plaçant à cet endroit, on laisse derrière soi l’agitation mondaine et l’insignifiance, et l’univers filmé vient occuper la plus grande partie de notre champ visuel. Une condition de l’agrément de la séance est remplie.
Il a existé pourtant une salle où nous avons accepté de nous retrouver au balcon, essentiellement pour des raisons d’impécuniosité. À la fin des années soixante, le Capitole d’Avignon, qui n’offrait pas moins de trois étages de balcon, vendait ses places de moins en moins cher avec l’altitude. Dans ces conditions, nous n’hésitions pas. Il valait mieux ne pas arriver en retard pour ne pas avoir à chercher une place dans le noir, car les ouvreuses ne s’aventuraient pas jusque-là, se doutant bien qu’aucun pourboire n’était à attendre de ce genre de spectateurs fauchés. Le propriétaire de la salle laissait ce dernier étage quasiment à l’abandon, et les trois quarts des sièges y étaient crevés, laissant échapper le crin de leur rembourrage et les ressorts de leur suspension. Il fallait chercher longtemps une place non endommagée. L’odeur, pendant les mois de juillet et d’août, en l’absence de toute climatisation, était indescriptible. Les films — principalement de Pagnol — vus là à cette époque restent parmi nos plus beaux souvenirs de cinéma.
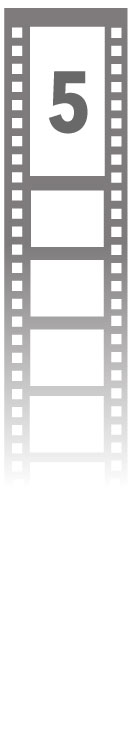
LE CONFORT
Une fois assis, il faut apprivoiser sa place. L’observateur extérieur apprécie le confort des sièges à la violence des contorsions et à l’intensité des soupirs montant des divers points de la salle occupés par des êtres humains essayant de se plier aux formes des fauteuils.
Aux derniers rangs, la difficulté n’est pas insurmontable. Le spectateur n’a qu’à s’asseoir le dos raide et vertical, plaqué contre le dossier, cuisses parallèles et jambes verticales, pieds posés à plat sur le sol, comme en visite dans un salon surchargé de bibelots précieux. Le dossier étant trop bas pour arriver au-dessus des épaules d’une personne de taille moyenne, la tête ne peut s’y appuyer; elle doit donc se reposer entièrement sur le cou pour la soutenir, légèrement inclinée vers l’arrière pour amener le regard face à l’écran.
Pour le spectateur qui a choisi une place dans les premiers rangs, c’est une autre histoire. L’écran se trouvant placé très haut par rapport à ses yeux, il doit incliner extrêmement la tête en arrière. Le seul support disponible est le dossier, très souvent en bois. Les délicates vertèbres de la nuque réclament alors un coussin pour adoucir la meurtrissure qu’il provoque. En hiver, on a son manteau, et durant les demi-saisons on peut facilement, à condition de choisir la souplesse au lieu de la tiédeur, disposer d’un pull / tricot / cardigan. L’été, hélas, à moins de l’avoir spécialement prévu, on est obligé de se passer de rembourrage. Et je ne parle pas des sièges type SNCF, qui poussent l’aberration, par une surépaisseur en haut du dossier, jusqu’à vous forcer à incliner la tête, et donc le regard, vers le bas, alors que l’objet de son attention, l’écran, est bien entendu en haut.
Les séances sont très douloureuses.
Ce n’est pas la seule conséquence de la faible hauteur du dossier: pour appuyer la nuque sur celui-ci, le dos humain n’étant ni rétractable ni compressible, il faut faire glisser les fesses jusqu’au bout du siège. Notons que la colonne vertébrale se trouve de ce fait casée dans un espace orthogonal (siège horizontal et dossier vertical). Bien que, pleine de bonne volonté, elle essaie de se conformer à cet espace, elle n’y parvient que très faiblement, et au prix d’un inconfort, et même d’un malaise, assez sévères.
L’espacement entre deux rangées de sièges est proche de celui adopté par les charters de cinquième catégorie, et lorsque le spectateur veut abaisser sa nuque sur le dossier et faire coïncider ses fesses avec le bout du siège, il rencontre au bout de ses genoux (à moins d’être au premier rang) un obstacle inamovible: le dossier du siège de la rangée de devant. Il ne lui reste plus qu’à remonter ses genoux et à les appuyer contre le dossier en question. Il doit bien sûr penser à ne pas manifester violemment pendant la projection des mouvements ou des tremblements incontrôlables, car le spectateur installé devant lui se retournerait pour lui exprimer tout aussi férocement son désir de le voir se calmer.
Une autre position, assez peu appréciée et heureusement assez rare, se rencontre également. Dans les cas de grosse affluence (festivals, projections uniques, Cinémathèque), on se retrouve assis par terre devant le premier rang, empêchant les assis d’allonger leurs jambes et leur causant des courbatures assez graves. Faute d’un instrument adéquat pour tenir sa tête et donc son regard fixé sur l’écran, on se retrouve rapidement allongé par terre, au prix d’une déformation de l’écran et d’une tendance au sommeil favorisée par la fatigue accumulée, l’heure tardive et l’association d’idées avec un lit, dont la moquette plus ou moins propre n’a cependant pas du tout le confort.
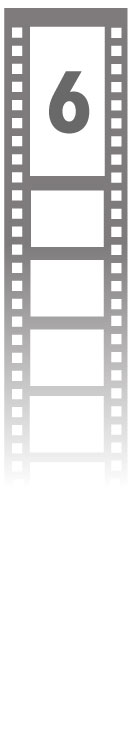
LES ACCOUDOIRS
À l’exception des séances bondées, pendant lesquelles les spectateurs ordinaires sont obligés d’y prendre place s’ils tiennent à voir le film ce soir-là, les premiers rangs sont recherchés uniquement par les cinémaniaques. Ils sont donc rarement surpeuplés. Nous retrouver entre deux sièges inoccupés nous arrive donc très souvent. Nous poussons même parfois le raffinement et le désir de tranquillité jusqu’à nous séparer des amis avec lesquels nous sommes venus. Nous apprécions alors pleinement le plaisir d’étaler nos bras sur les sièges voisins.
Lorsque ces premiers rangs sont occupés, et par des personnes inconnues de nous, nous savons que le début de la séance va être consacré à une lutte silencieuse et courtoise, mais néanmoins sans merci: celle pour la conquête des bras du fauteuil.
Entre habitués, on a justement l’habitude. On se relaie poliment dans l’occupation par les coudes de ce support commode. D’autres spectateurs ignorent ce savoir-vivre, et font mine d’installer pour la séance entière sur le bras de notre fauteuil, qui est en partie le leur, un coude pointu et envahissant, se projetant parfois jusqu’à nos côtes. Certains même, inconscients en cette époque révolue de l’étroitesse des fauteuils, semblent se gonfler jusqu’à envahir une partie de notre espace.
Il nous faut alors adopter une stratégie de vigilance. Glisser dans le plus petit espace entre le bras du voisin et celui du fauteuil un coude discret mais sûr de son bon droit. Un réflexe de courtoisie incitera parfois le voisin à pousser légèrement son bras de façon à libérer un peu de place. Sinon, il faut guetter le moindre de ses mouvements, saisie et utilisation d’un mouchoir, démangeaison irrépressible, crampe. Notre coude et l’avant-bras correspondant s’installent ainsi sur l’espace libéré. Les sympathiques nous laissent alors en jouir pendant quelques minutes, au bout desquelles nous cédons la place à notre tour. Les sinistres égoïstes nous font la gueule. Nous les laissons alors plus longtemps mariner dans leur inconfort.
Le Rio d’Avignon disposait avant de disparaître, et sans que sa disparition lui soit forcément liée, d’une bizarrerie assez intéressante. Dans toutes les rangées, les deux sièges du milieu n’étaient pas séparés par des accoudoirs, formant une banquette à deux places appréciée des couples tendres ou des isolés désireux de s’étaler.
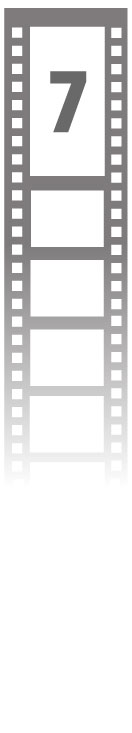
LES RIDEAUX
Au temps des doubles rideaux devant les écrans, les projectionnistes étaient comme la nature: ils avaient horreur du vide.
En entrant dans la salle avant le début de la séance, ou à l’entracte avant le début du film, le spectateur voyait offert à ses regards, masquant l’écran de projection, un écran illustré de publicités pour les commerçants locaux: pâtissier, marchand de meubles, assureur, garagiste, opticien… Puis les lumières baissaient graduellement, pendant que deux rideaux de velours, généralement rouges, jusque-là rabattus de chaque côté, glissaient horizontalement devant l’écran publicitaire, dans un bourdonnement feutré. Une fois ceux-ci ajustés bord à bord, un autre moteur démarrait: c’était celui de l’écran publicitaire, fonctionnant comme un store et s’enroulant sur sa barre horizontale qui remontait jusqu’au plafond. Le bourdonnement de ce moteur s’arrêtait alors dans un hoquet, pour être remplacé par celui des rideaux qui s’écartaient en découvrant enfin l’écran blanc.
Toutes ces opérations, qui duraient deux bonnes minutes, s’effectuaient dans la pénombre, seules de petites veilleuses restant allumées. Les rideaux revenus à leur position ouverte, mollement rassemblés à droite et à gauche de l’écran blanc, le projectionniste commandait alors le noir complet dans la salle, où ne restaient allumés que les blocs de secours marqués «sortie», et débutait la projection.
La plupart des projectionnistes, pour des raisons impossibles à élucider, lançaient leur appareil bien avant que les opérations de levage, écartement et enroulement de tous les rideaux aient été achevées. Le générique du film se déroulait donc à la fois sur un fond ondulant de velours rasé et sur un autre de publicités peintes sur toile qui disparaissaient à partir du bas, y compris le fond sonore, impropre au recueillement, de vrombissements de moteurs et de claquements d’engrenages, sans oublier les cris des quelques maniaques des premiers rangs qui criaient «rideau!», en pure perte bien entendu.
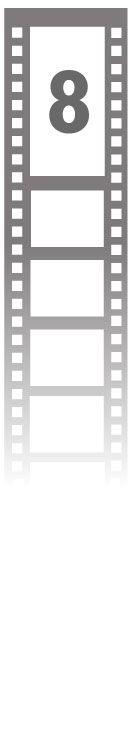
LE POINT
Le cinéma, c’est beaucoup une question de regard. Cela va encore mieux en le disant. Mais ce n’est pas parce que notre vue est mauvaise que nous nous installons dans les premiers rangs, ou que nous sommes les seuls à crier «le point!» dès que la projection devient floue. Certains projectionnistes, aux lunettes mal adaptées, ou à la myopie non corrigée, ne règlent pas leur objectif suffisamment finement pour que nous puissions contempler une image parfaitement nette.
Nous voyons le défaut et voulons qu’il soit corrigé, alors que les autres spectateurs ne s’en rendent pas compte et sont prêts à tout avaler, les personnages sans tête coupés par un format inadapté, les génériques illisibles, les sons crachotants et les fins de bobines charcutées. Ce manque d’exigence nous écœure.
Avant le règne de l’à-peu-près et le triomphe de l’aveuglement chez le spectateur moyen, nous sommes assez nombreux à prendre notre voix la plus forte pour crier “le point!” à l’intention de l’opérateur dans sa cabine. Son ouïe étant en bien meilleur état que sa vue, le manque de netteté est en général rapidement corrigé.
On connaît tout de suite, à la prononciation du mot, la région d’origine de chaque trublion. Dans les salles du Nord, le mépris virulent que le malheureux originaire d’une contrée occitane doit affronter le réduit rapidement au silence.
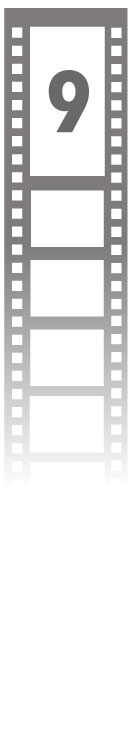
LES BOBINES
Les films sont aujourd’hui projetés sur un seul appareil, à moins de dépasser les trois heures de projection. L’une des activités professionnelles du projectionniste consiste à assembler les six ou sept bobines que la salle a reçues du distributeur sur une seule grosse galette, par des collures qu’il défera à la fin de la semaine de projection du film, ou à la fin de la séance en cas de projection unique.
Il n’en a pas toujours été ainsi. Les cabines pour le 35 millimètres étaient équipées de deux appareils, qui projetaient les bobines du film telles que reçues, en alternance. Une petite aventure advenait donc à chaque changement de bobine, vécue par nous dans l’inquiétude en cas de copie en mauvais état. Le projectionniste devait effectuer toutes les vingt minutes environ, durée d’une bobine normale, une série d’opérations dont la parfaite synchronisation garantissait la qualité de la projection. Au début de la séance, les deux projecteurs étaient chargés, l’un avec la bobine 1, l’autre avec la bobine 2. À la fin de la bobine 1 sur le projecteur 1, signalée quelques images auparavant par des marques variées sur l’image (petits cercles blancs, croix, et taches dues à l’usure plus grande de la pellicule en cet endroit), il devait faire démarrer le projecteur 2, en laissant le cache en place devant l’objectif. La bobine 2 déroulait alors son amorce (bande de pellicule noire sans image, marquée par une série de chiffres décroissants, jusqu’à 3). Lorsque l’amorce avait terminé son déroulement, la bobine du projecteur 1 était sur le point d’être terminée. Alors le projectionniste, simultanément, masquait le projecteur 1 et dévoilait le projecteur 2. Pour le spectateur dans la salle, le film se déroulait sans rupture autre que celle voulue par le réalisateur, dans les cas de copies neuves et de projectionniste confirmé. Dans les autres cas, copie à la limite de l’épuisement, déjà projetée des centaines de fois, projectionniste novice, stagiaire, débutant, ou incompétent, on voyait les amorces, les deux bobines de superposaient un instant, les chiffres de la fin d’amorce remplaçaient une image interrompue au milieu d’un mouvement ou d’une phrase. Dans certains autres cas (assoupissement du projectionniste), le film s’arrêtait carrément: le deuxième projecteur n’avait pas du tout démarré. Il fallait que les cris des spectateurs réveillassent le technicien et le vouassent à la damnation. La projection reprise, et le ronron du projecteur repris pour près de trente mille images, le projectionniste devait alors rembobiner la première bobine, et la remplacer sur le projecteur 1 par la bobine 3, prête à alimenter dès que nécessaire l’écran en images et en sons.
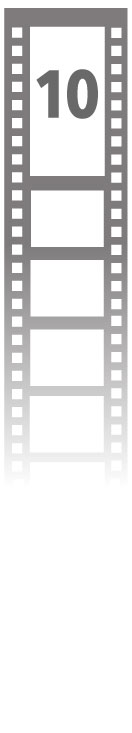
LE FORMAT
Aucun lecteur, qu’il ait entre les mains une œuvre de Faulkner ou un volume de la collection Harlequin, ne supporterait de devoir demander au libraire les dernières pages de son livre, ou les dernières lignes de chaque page. Le libraire, si le cas se produisait pour un livre d’occasion, rembourserait sans barguigner l’acheteur mécontent. Quant à l’éditeur d’un livre neuf ainsi raté, il mettrait au pilon sans hésiter l’ensemble du travail défectueux, sans oublier d’arroser l’imprimeur responsable d’une forêt vierge d’injures. Aucun amateur de peinture ne tolérerait qu’on ne lui présentât que des œuvres tronquées, dont le conservateur du musée, le commissaire d’exposition ou le galeriste aurait replié quelques décimètres en haut et en bas.
Au cinéma, on tolère. Des milliers de spectateurs assistent tous les jours, dans les salles ordinaires, ou dans des salles dotées d’un label d’art et essai qu’elles ne méritent pas, à des projections pendant lesquelles chacune des cent cinquante mille images que compte le film est amputée sur l’écran d’un bon tiers de sa hauteur. C’est ainsi que dans les gros plans, les personnages sont coupés au-dessus des sourcils, alors que le réalisateur avait prévu de montrer les branches de l’arbre sous lequel ils sont assis. Si le film est sous-titré, cela peut être pire: pour que les sous-titres restent visibles, le bas de l’image est projeté intégralement, mais le projectionniste est obligé de couper encore davantage la partie haute.
Il est très rare que les spectateurs protestent, non par l’effet d’une soudaine timidité, mais hélas par le fait d’un aveuglement: il ne se sont pas rendu compte du défaut. Lorsque nous le leur expliquons en le démontrant, ils ne sont pas plus scandalisés. Il n’est pas rare en revanche que le connaisseur qui perd quelques minutes pour monter à la cabine et demander au projectionniste l’établissement de conditions normales se voie repousser comme un animal nuisible, un triste empêcheur de saboter le film en rond, et que le technicien argumente que le format est correct, sans oser avouer que l’appareil n’a pas l’objectif 1,33 nécessaire…
L’évolution des techniques et le désir de différencier le cinéma de la télévision ont entraîné une diversification des standards, un fouillis de spécifications différentes et malheureusement une inattention totale aux exigences d’un travail correct.
Il arrive rarement qu’un film tourné en cinémascope soit projeté dans un autre format: du fait du procédé d’anamorphose employé, la non utilisation de l’objectif adéquat se voit tout de suite: l’image est resserrée en largeur. C’est une autre histoire pour les autres films, ceux antérieurs aux années soixante, tournés au format classique, le 1,33.
Peut-on parler ici aussi de l’horreur du vide? Emplir entièrement un écran rectangulaire avec une image presque carrée suppose une technique à la Procuste: couper ce qui dépasse. Un objectif inadapté fait ce beau travail tout seul. Le projectionniste intervient en choisissant la zone de coupure: en haut ou en bas. Pour les films sous-titrés, la solution s’impose d’elle-même, suite aux hurlements des spectateurs privés de sous-titres et incapables de suivre le film.
La même catastrophe se produit aujourd’hui à la télévision avec le nouveau format dit 16/9°.
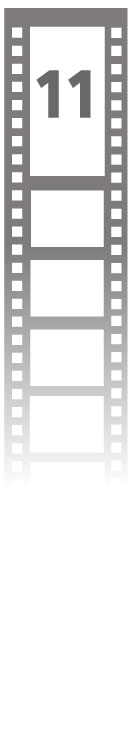
LA PLUIE
Dans les années soixante, sur l’unique chaîne de télévision, pendant les mois de juillet et d’août, il ne faut pas manquer le passage de la speakerine après le journal de 13 heures. Pour peu que la pluie sévisse sur la région parisienne, elle annonce la diffusion d’un film l’après-midi même sur tous les émetteurs du pays. Ce film n’est jamais un chef d’œuvre impérissable, trop souvent un navet de série Z, toujours une VF pour les films étrangers, mais il est parfois intéressant. Nous restons volontiers sourds aux appels du soleil et indifférents aux longues promenades dans les sous-bois attiédis. Nous sommes sensibles à ces films en quelque sorte volés, non prévus, en dehors des programmes. C’est l’époque où les quotas n’existent pas.
Malheureusement, le système, bien que propice à ce genre de gâteries, a aussi son mauvais côté. Il arrive souvent qu’après une heure de film, nous nous retrouvions suffoquants d’indignation, livrés sans recours à ce qui n’est pas encore la dictature de l’audimat, mais déjà celle du «sport». Le film s’est interrompu, au milieu d’une séquence, au milieu d’un plan, au milieu d’une réplique, sans que l’on nous annonce en aucune manière l’heure de sa reprise, sans même qu’on nous l’assure ou nous la promette : une étape supplémentaire du tour de France cycliste arrive à son dénouement, et il faut que l’entière France téléspectatrice en prenne connaissance.
Ces pratiques, ignorant les plus élémentaires droits de l’œuvre et du spectateur, répétitives et impunies, nous ont laissé, d’une façon qui semble indélébile, la haine du sport en général, et du sport-à-la-télé en particulier.
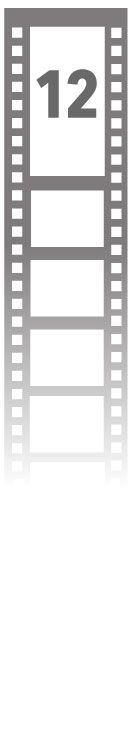
LA PUBLICITÉ
Économiquement, ça se passe de la façon suivante: les salles louent les films au distributeur, elles louent le court métrage de première partie, elles louent même les actualités et leur inénarrable voix rétro. La projection de toutes ces richesses (tels les courts métrages sur la culture des raviolis en Mongolie Extérieure…) est comprise dans le prix du billet.
Le seul élément du programme que les salles ne paient pas, et qu’elles sont même payées pour projeter, c’est la publicité. Nous estimons que c’est leur seule excuse. Fort heureusement, elles sont réglementairement obligées de projeter ce déballage de propagande commerciale sans éteindre la salle. Ceci permet à l’ouvreuse de passer le quart d’heure de l’entracte à vendre les célèbres eskimos et les bonbons acidulés au papier crissant dont la consommation fait un peu plus tard les délices de certains spectateurs et le supplice auditif des autres. Ceci nous permet également, lorsque nous sommes venus seuls à la séance, d’ouvrir et de consulter le journal, le livre, le manuel, le carnet de notes que nous avons été assez prévoyants pour apporter avec nous. Nous n’avons jamais vu une seule de ces publicités. Nous ne nous en portons pas plus mal.
Aujourd’hui, le règlement subsiste, mais il est rare que la salle reste suffisamment éclairée pour permettre de lire. Nous n’y entrons plus jamais au début de la séance.
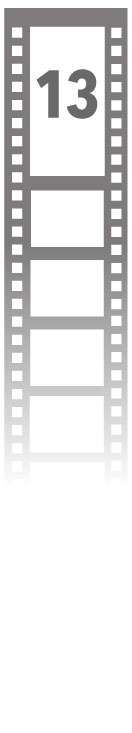
LES CITÉS U
Étudiants, donc peu argentés, en tous cas pas encore installés, nous ne disposons pas d’un poste de télévision. Nous n’habitons pas chez nos parents, ou ceux-ci n’ont pas la télé. Nous pouvons quand même voir les films que celle-ci diffuse. Il existe, fort heureusement pour nous, les cités universitaires. Un de leurs pavillons comporte, aménagée au rez-de-chaussée et ouverte à tous, contrairement aux chambres réservées aux résidents, une salle équipée d’un récepteur, bloqué sur l’une des deux chaînes que compte à l’époque l’ORTF. Plus tard, une salle sera consacrée à chaque chaîne, avec un récepteur verrouillé.
La salle est suffisamment grande, et les sièges suffisamment nombreux pour les émissions qui nous intéressent, constituées exclusivement des diffusions de films : le ciné-club de la deuxième chaîne tout d’abord, seule plage de version originale, et d’autres horaires et jours fixes et récurrents, tels le dimanche soir sur la première chaîne, ou le dimanche après-midi.
Il nous arrive, venant vers 22 heures un vendredi soir pour un inédit de Hawks ou une rareté de Murnau, de tomber sur une salle pleine de gens assis par terre, entourés de canettes de bière, et rien moins que calmes. Notre stupéfaction et notre angoisse ne sont dissipées que par la vérification d’un retard dans la diffusion: l’émission qui attire tant de monde, ce n’est pas le ciné-club, mais le match-de-foot malencontreusement pour nous programmé juste avant.
Il nous faut alors subir pendant de longues minutes les cris pleins d’à-propos et d’élégance des supporters enthousiastes, avant que la salle se vide tel un préau à la fin de la récréation, ou plutôt un fumoir à la fin de l’entracte, et que nous puissions prendre enfin place devant l’écran, dans une atmosphère de sueur, de renfermé et de cigarette à couper au sécateur, mais tout de même presque seuls.
Comment font-ils, maintenant, dans les cités U, avec six chaînes?
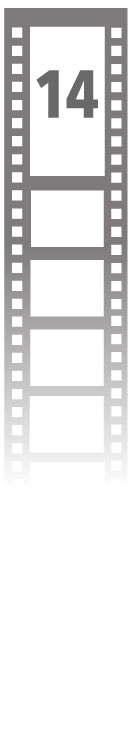
LE PETIT CARNET
Après avoir vu un nombre considérable de films, beaucoup plus que le spectateur moyen, lorsque nous comprenons que le cinéma va devenir l’essentiel de notre vie, nous décidons de tenir le livre de bord de tous les films que nous voyons. Il nous sert de journal intime. Nous achetons dans une papeterie un petit carnet à ressorts, quadrillé, de format 10×15. Nous y inscrivons le titre et le réalisateur de chaque film que nous voyons, au cinéma ou à la télévision, dans les séances normales ou les festivals, les ciné-clubs ou les cours universitaires.
Mois après mois, le carnet se remplit. À la fin de chaque mois, nous faisons le total. Au verso de la couverture, nous inscrivons le nombre de films vus mois par mois, et le total sur l’année. Il est impressionnant.
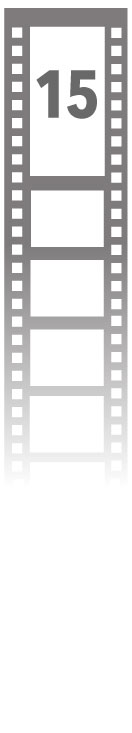
LES VOISINS
Il n’y a que deux chaînes de télévision, et elles ne fonctionnent pas vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le cinéma fait cependant partie de leurs programmes. Hélas, pour les voir, ces films à la télé, c’est souvent toute une histoire.
Il arrive, en vacances, en week-end, que nous soyons contraints de regarder la télé, ou plutôt le film qui y est diffusé, chez nos parents, chez les voisins, chez leur propriétaire.
Plusieurs jours avant la date du film, l’angoisse monte. Allons-nous pouvoir regarder ce film dans des conditions acceptables?
Il faut d’abord vérifier qu’aucune concurrence, sur l’autre chaîne ou parmi les obligations mondaines du récepteur concerné, ne va jeter à l’eau notre rendez-vous. Il faut quémander une séance.
Bien entendu, nous ne faisons ce cirque que pour les chefs d’œuvre. Les films de série B ou les cinéastes peu prisés, fussent-ils renommés, ne nous comptent pas ce soir-là parmi leurs spectateurs.
Il est arrivé trop souvent que nous soyons empêchés de goûter le début, pendant près d’un quart d’heure, par des tentatives de conversation de la part de nos hôtes, dont nous essayons alors de décourager les tentatives de sociabilité mal à propos, en répondant par borborygmes ou en essayant d’attirer leur attention vers l’écran. Il est arrivé également que des retardataires, ou des visiteurs imprévus, viennent s’installer en cours de diffusion, avec les inévitables vacarmes de chaises et de salutations.
Et puis, chaque fois, les moments les plus intenses, les plus poignants, sont inévitablement brouillés par des commentaires intempestifs bien que peu vulgaires vu l’âge respectable de leurs proférateurs, mais dont le pouvoir de dérangement est comparable à celui provoqué par les fascistes et les analphabètes assistant en masse aux séances des ciné-clubs des facultés de droite. Là encore il faut, par un silence abyssal, décourager les désirs de partage et d’échange d’opinions.
Le comble de l’horreur est atteint lorsque l’un des hôtes, sans penser du tout à mal, se lève d’un pas lourd, se dirige vers le poste, et change brusquement la chaîne diffusée. Ce n’est qu’au bout de plusieurs interminables secondes que nous arrivons à obtenir que l’on revienne au film pour en voir la fin, avant de s’intéresser aux informations ou au sport.
La diffusion terminée, il est vain de vouloir s’y consacrer quelques instants en silence. Dans le meilleur des cas, la conversation obligatoire porte sur les nouvelles de la famille, des études, du temps. Dans les autres, il faut parler un peu du film, des jambes de la starlette.
Notre passion est si forte que nous préférons voir les films dans ces conditions plutôt que de nous en passer.
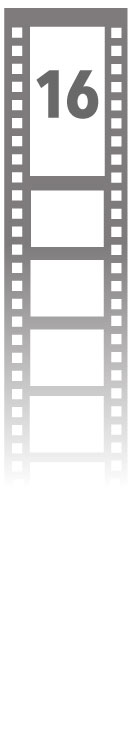
GÉNÉRIQUE DE FIN
Tout le monde n’assiste pas à la projection jusqu’à la fin du film. Certaines personnes se lèvent même avant le dernier plan, et entreprennent de sortir de leur rangée alors que leurs voisins sont encore assis. Ceux-ci sont alors obligés de se lever également, d’abord pour les laisser passer, ensuite pour tenter de voir malgré tout les dernières images. Les spectateurs assis derrière sont contraints à leur tour de se lever, et de proche en proche la fièvre gagne toute la salle.
Nous, devant, somme un peu moins malmenés. Nous sommes en compagnie de nos semblables, qui trouvent un plaisir dans la prolongation de la projection, dans le déchiffrement minutieux du générique de fin, qui permet parfois d’amusantes constatations, des rapprochements curieux.
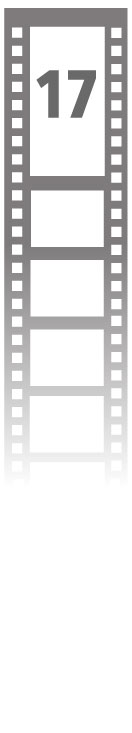
LA DRAGUE
À s’asseoir aux places les plus proches de l’écran, une fille s’expose parfois à des désagréments.
Il arrive, à certaines heures et pour certains films, qu’un personnage visqueux, entré là par désœuvrement, parce qu’il pleut, parce qu’il croit les promesses du titre ou des quelques photos affichées à l’entrée, mais dont le cinéma est le dernier des soucis, s’imagine que cette silhouette solitaire, blottie dans son nid plus ou moins douillet, n’est pas là pour des motifs cinématographiques.
L’idée qu’on puisse aller au cinéma autrement que pour passer une heure et demie le samedi soir avant d’aller en boîte n’effleure pas certains exemplaires de la population.
Le personnage vient alors, très peu discrètement mais furtivement, s’asseoir tout près, un rang derrière ou deux fauteuils plus loin, et se met à faire des montagnes de simagrées, raclements de pieds, agitation de fauteuil, déploiement de mouchoir, à seule fin d’attirer l’attention sur lui, et de faire tourner la tête de sa proie. Il se croit de toute façon autorisé à faire à voix basse des propositions irréalisables.
Il nous faut alors changer de fauteuil, soulevant alors sa réprobation brutale et une explosion d’invectives.
Quant au film, pendant ce temps, il continue à se dérouler imperturbablement.
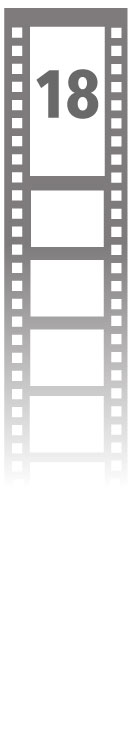
APPRENTISSAGES
On est ébloui par la quantité de choses que l’on a apprises en allant au cinéma — en voyant des films. Les langues étrangères, par exemple.
Après avoir étudié pendant sept ans l’anglais au collège et au lycée, on a pu s’apercevoir à l’occasion d’un voyage que l’on est non seulement incapable de prononcer compréhensiblement une phrase quotidienne, mais également de comprendre celles à nous adressées par des autochtones exaspérés.
Il se trouve que certains films, parmi les plus rares, sont projetés à la Cinémathèque en version originale non sous-titrée. Les premières séances sont rudes. Nous tenons à voir tel film de Vidor ou de Hawks coûte que coûte. Nous nous retrouvons réduits à n’apprécier que les images. Les dialogues sont des borborygmes barbares, et nous ne comprenons rien à l’intrigue. Au fil des projections, nous nous faisons l’oreille à cette langue des films, tels des bébés apprenant à parler grâce à l’amour de leurs parents. Ce sont des films américains, et nous ne sommes pas plus avancés à Londres. En revanche, la cinéphilie se porte bien…
Bien entendu, dans le cas des films de Ozu, c’est une autre paire de manches. On apprend cependant à différencier les idéogrammes japonais des chinois. Tout fait ventre. On apprend à dire «je t’aime» en suédois, et même «rien» grâce à Bergman. Et que ne devons-nous pas au Printemps de Prague !
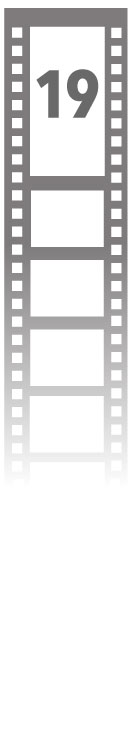
LE NOM DES SALLES
Où que nous allions sur le territoire français, nous sommes à la maison. Nous retrouvons partout le paysage consubstantiel à notre existence: les cinémas. Comme on irait chez soi de pièce en pièce à la recherche de l’endroit où se livrer jour après jour à son plaisir favori, nous allons de salle en salle, de Capitole en Cinévog, de Casino en Régent, de Sélect en Français, sans oublier le Lynx, le Vox, le Lux, le Rex et parfois le Roxy. Les anciens théâtres ont conservé leurs loges, très peu commodes pour une vision frontale de l’écran. Les anciens music-halls ont leurs dorures et leur velours. Les différents Studios du territoire ont chacun leur numéro: 24, 28, 34… celui de l’emplacement de leur immeuble dans la rue, celui de leur département.
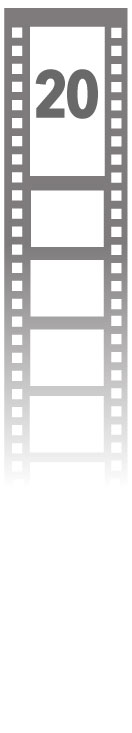
LE DÉBUT
L’obscurité s’installe. Le spectateur aussi. Il appuie ses genoux repliés contre le dossier du siège devant lui, ou bien, si sa morphologie le lui permet, il passe carrément ses jambes par-dessus, au risque de voir l’ouvreuse arriver au galop, lui braquer sa lampe de poche en pleine figure, et lui intimer l’ordre de s’asseoir correctement d’une voix que n’embarrasse aucun souci de discrétion.
L’indicatif de la maison de production du film éclate sur l’écran. Les derniers claquements de sièges, les échanges de nouvelles entre spectateurs retardataires, les froissements de papier s’apaisent dans la salle.
À partir de ce moment, c’est une autre histoire.
